Comme chacun sait la guerre de Cent ans commence en 1337 lorsque le roi d’Angleterre Edouard III a revendiqué la couronne de France. Certes. Mais la guerre de Cent ans a été précédée de deux cent ans de guerres entre la France et l’Angleterre, entrecoupées de trêves et de paix rompues. Les prémices de la guerre de Cent ans racontent ces deux cent années de conflits entre les ducs d’Aquitaine-rois d’Angleterre et les rois de France. Les deux articles de la série du 10ème siècle qui suivront traiteront de la genèse des comtés d’Armagnac d’une part, d’Astarac d’autre part, jusqu’à la guerre de Cent ans.
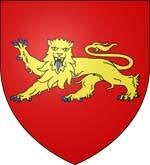
Duc d'Aquitaine
Le duché d'Aquitaine absorbe le duché de Gascogne
L’origine de ce conflit interminable remonte loin dans le temps. En 990 Guillaume-Sanche est duc de Gascogne, arrière-petit-fils de Garcia-Sanche dit le Courbé, dont il a été question dans l'article 06-01. Son fils ainé Bernard-Guillaume, puis son second fils Sanche-Guillaume lui succèdent. Une de ses filles, Brisque, épouse Guillaume V, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine. A la mort de Sanche-Guillaume en 1032, son neveu Eudes de Poitiers, duc d'Aquitaine, hérite du duché de Gascogne. Il meurt en 1039. Le duché de Gascogne échoit alors à Bernard II, dit Tumapaler, comte d'Armagnac. Bernard II est fils de Géraud 1er, comte d'Armagnac, et d'Adelaïs, sœur d'Eudes de Poitiers. Le duc d'Aquitaine est alors Guillaume VIII, demi-frère d'Eudes. Dès 1044 il conteste à Bernard d'Armagnac la possession du duché de Gascogne. La dispute se termine en 1062 où Bernard est battu par Guillaume à la bataille de La Castelle, près de Grenade-sur-Adour. Les duchés d'Aquitaine et de Gascogne ne font alors plus qu'un et Bernard Tumapaler est "indemnisé" d'une somme de 15 000 sous. C’est ainsi que le comte d’Armagnac devint vassal du duc d’Aquitaine.

Les flèches de couleur bleu indiquent la succession des ducs de Gascogne, les flèches de couleur rouge celle des ducs d'Aquitaine
La partie nord-ouest de la Gascogne est alors incluse dans le duché d’Aquitaine, et la partie sud-ouest, de duché devient comté de Gascogne. Le Béarn prend son autonomie, lorsque le vicomte de Béarn rend hommage au roi d'Aragon. Les comtes et vicomtes de l’ancien duché de Gascogne mènent alors entre eux une politique plus ou moins autonome, entre brouilles, mariages, guérillas, et alliances. On évoquera dans les articles 10-04 et 10-05 ce qui adviendra des comtés d’Armagnac et d’Astarac.
Guillaume IX, fils de Guillaume VIII épouse Filippa, la fille du comte de Toulouse. Au décès du comte de Toulouse le comté revient à Raymond, le frère cadet de Filippa, mais Guillaume IX conteste cette succession et occupe Toulouse alors que Raymond est parti en Terre Sainte. Guillaume en est chassé peu après mais cet épisode laisse aux ducs d’Aquitaine une revendication larvée sur Toulouse et son comté.
Aliénor d’Aquitaine reine de France, puis reine d’Angleterre
Guillaume X d’Aquitaine, le petit-fils de Guillaume VIII, meurt en 1137 laissant la couronne d’Aquitaine à sa fille Aliénor. Aliénor épouse le roi de France Louis VII en 1137. Après l’annulation de ce mariage, Aliénor épouse en 1152 Henri Plantagenet. Henri Plantagenet est comte d’Anjou, du Maine, du Perche, du Vendômois, de Touraine et duc de Normandie, fils de Geoffroy d’Anjou et de Mathilde, fille ainée du roi d’Angleterre Henri 1er.
Après son mariage avec Aliénor Henri ajoute l’Aquitaine à ses domaines. A l’époque d’Aliénor, l’Aquitaine comprenait le duché d’Aquitaine proprement dit (Bordeaux et Angoulême), une partie de l'ex-duché de Gascogne, le comté du Périgord, la vicomté du Limousin, et le comté d’Auvergne.
Un an après son mariage avec Aliénor Henri devient roi d’Angleterre sous le nom d'Henri II. Le nouveau roi d’Angleterre prend possession de l’Aquitaine en tant que duc en 1154. Le roi d’Angleterre avait maintenant en France des domaines plus étendus que ceux du roi de France. Les rois de France ne pouvaient accepter d’avoir un vassal plus puissant qu’eux. La guerre durera trois cent ans.
Aliénor et Henri d'Angleterre eurent neuf enfants, dont Richard, dit Cœur de Lion, et Jean, dit Sans Terre. C’est à Poitiers qu’Aliénor éleva ses enfants.
Première guerre de cent ans : l’Angleterre perd toutes ses possessions au nord d’une ligne La Rochelle – Clermont-Ferrand
La guerre de Guyenne et Gascogne commence en 1159 lorsque Henri II fit le siège de Toulouse. Louis VII intervint pour soutenir le comte de Toulouse et Henri II échoua, mais il s’empara néanmoins d’une partie du Quercy, et de l’Agenais. Les ducs d'Aquitaine avaient tenté plusieurs fois dans le passé de s'emparer du comté de Toulouse, et avaient toujours échoué.

La France à l’avènement de Philippe Auguste - En bleu le domaine royal français
En rouge sombre le domaine Plantagenet - En rouge plus clair le duché d’Aquitaine d’Aliénor
(Wikimédia Commons - Map France 1180-fr.svg)
Philippe Auguste succède à Louis VII en 1180. Il soutient la révolte de Richard Cœur de Lion contre son père et mène plusieurs combats contre Henri en Normandie. Henri II meurt en 1189. Une trêve est conclue pendant la troisième croisade. Après le retour de croisade de Richard, les combats reprennent toujours en Normandie. Après la mort de Richard en 1199 les hostilités continuent entre Philippe Auguste et Jean Sans Terre. En 1204 Philippe achève la conquête de la Normandie. Après la quatrième croisade les hostilités reprennent en 1212 en Flandre. L’affrontement final a lieu en 1214 à Bouvines où les troupes anglaises sont défaites. Jean Sans Terre perd toutes ses possessions au nord de la Loire. On n'entrera pas dans le détail de la situation du duché de Bretagne, assez complexe. Ce duché a été possession d'Henri II de 1166 à 1213.
Henri III succède à son père Henri II en 1216. Louis, futur Louis VIII, profite de la minorité d’Henri III pour conquérir toutes les possessions des Plantagenets en Aquitaine, sauf Bordeaux et la Gascogne. Philippe Auguste meurt en 1223. Ce qu’il reste de l’Aquitaine d’Aliénor est alors appelé du nom de Guyenne.
Dans le même temps avait lieu la croisade contre les Albigeois. Elle fut proclamée en 1209. En 1226 les vicomtés de Carcassonne, d'Albi et de Béziers sont annexés au domaine royal du roi de France. Le comté de Toulouse devient possession d'Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis en 1242.
En 1230, puis en 1242 Henri III mena deux expéditions en France pour tenter de reconquérir les possessions des Plantagenet, mais il échoua. Il faut dire qu’au cours de ces mêmes années il était également en guerre contre les Gallois et contre les Ecossais.
En 1245 les seigneurs gascons des vicomtés des Landes, avec à leur tête Gaston VII de Béarn, se révoltent contre les sénéchaux anglais mis en place par Henri III. Puis les paysans du bordelais se révoltent à leur tour. Henri III débarque à Bordeaux avec une armée en 1252 et les Gascons doivent faire leur soumission. Henri III nomme alors son fils futur Edouard 1er gouverneur de Guyenne et Gascogne, ce qui n'empêche pas Gaston de Béarn et de Bigorre de faire hommage au roi d'Aragon en 1254.
Henri III signe avec Saint-Louis en 1259 le traité de Paris qui reconnait la suzeraineté anglaise sur la Guyenne, le Limousin, le Périgord, le Quercy, l’Agenais et la Saintonge et met fin à la première guerre de cent ans. Le roi de France conserve les provinces confisquées par Philippe Auguste : Normandie, Touraine, Anjou, Poitou et Maine. Henri III rend hommage au roi de France l’année suivante pour toutes ses possessions, y compris la Gascogne. Depuis cet hommage, les comtes et vicomtes gascons peuvent désormais faire appel en justice au Parlement de Paris et au roi de France lorsqu’ils ont des litiges avec le roi d’Angleterre. La capitale du duché est alors transférée de Poitiers à Bordeaux.

La France après la signature du traité de Paris de 1259
Les historiens insistent sur la misère des campagnes au cours de la guerre de Cent ans. Il faut certainement considérer que les misères, entre autres en Gascogne, ont commencé dès les débuts du conflit. Même s’il n’y a pas eu de batailles rangées en Gascogne, l’insécurité, le brigandage régnaient, tout un chacun pouvait craindre le passage de troupes plus ou moins contrôlées dans les villes et villages. C’est dans ces années troublées, bien avant les débuts de la guerre de Cent ans, que des châteaux fortifiés, des bourgs-castraux ont été bâtis, que des remparts ont été édifiés un peu partout. On ne pouvait compter sur aucune autre protection que celle de son seigneur. Les fortifications du 12ème siècle en Astarac seront évoquées dans un prochain article.
Seconde guerre de cent ans : l’Angleterre se maintient en Guyenne et Gascogne
Les trente ans qui suivent le traité de Paris, de 1260 à 1290, sont trente années de paix. En 1271, Louis IX décède à Tunis pendant la dernière croisade. Son fils Philippe III lui succède. Toulouse et le Languedoc sont alors rattachés au domaine royal. Le roi de France a désormais un Sénéchal à Toulouse qui gouverne en son nom. Le Sénéchal est assisté d’un Connétable, chargé de la gestion financière. L’année suivante, après la mort du roi Henri III, son fils Édouard Ier rend hommage à Philippe III. Ce n'est qu'en 1279 que l'Agenais est restitué au roi d'Angleterre, conformément aux termes du traité de 1259, puis la vicomté de Gaure en 1287.
La première bastide d’Astarac, Masseube, est fondée en 1274. D’autres fondations suivront jusque dans les premières années du 14ème siècle, tant du coté français que du coté anglais.
Après la mort prématurée de Philippe III en 1284, Philippe IV le Bel monte sur le trône de France.
En 1293 la guerre franco-anglaise reprend à la suite d'un conflit entre marins bretons et marins basques. Philippe le Bel cite Édouard Ier à comparaitre devant le Parlement. Constatant le défaut du roi d'Angleterre, le Parlement de Paris prononce la confiscation du duché d'Aquitaine. Édouard débarque alors à Bordeaux avec une armée, mais échoue à reconquérir ses possessions. Les deux parties font appel au pape pour régler leur différend. Le pape décide du retour de la Guyenne au roi d'Angleterre. Une paix est conclue dans ces termes en 1299 au traité de Montreuil-sur-Mer entre Philippe le Bel et Édouard Ier. Le traité prévoyait également le mariage d’Isabelle, fille de Philippe avec le fils d’Édouard.
Au cours de ces mêmes années 1297-1305 la guerre contre l’Angleterre s’est à nouveau déplacée en Flandre où le comte de Flandre, vassal du roi de France s’était allié au roi d’Angleterre. Après avoir annexé la Flandre en 1301, les Français la perdent. Le traité d’Athis-Mons met fin à la guerre de Flandre à laquelle ont participé plusieurs seigneurs gascons.
Le mariage d’Édouard II avec la fille de Philippe le Bel en 1308 met provisoirement fin aux hostilités.
Au cours des quelques années suivantes, Philippe le Bel s’attaque aux Templiers dont le dernier acte se déroule en 1314, année également de la mort du roi. Charles IV succède à Philippe le Bel sur le trône de France.
Les hostilités entre roi de France et roi d'Angleterre reprennent en 1324. Charles IV au prétexte qu’Édouard n'a pas encore rendu l'hommage, confisque la Guyenne et envoie une armée qui occupe l'Agenais et la Guyenne sauf Bordeaux et Bayonne. En 1327 Édouard III monte sur le trône d'Angleterre. Charles IV lui rend son duché, mais garde l'Agenais. La mort sans héritiers du roi Charles IV en 1328 va rouvrir les hostilités entre la France et l'Angleterre, et cela pour cent ans. Ce sera la guerre de Cent ans.
Finalement Philippe Auguste est le roi de France qui a obtenu le plus de succès dans la reconquête des territoires perdus. Saint-Louis a signé en 1259 une paix de compromis qui a procuré une trêve de trente ans. Cette trêve a été rompue par Philippe le Bel mais il n’a obtenu que des succès éphémères. Et on peut concevoir que les fluctuations des possessions du roi d’Angleterre au sud de la Garonne durant le règne de Philippe le Bel ont eu de quoi dérouter les seigneurs gascons.
L’article consacré à la dernière guerre de cent ans, la "vraie" guerre de Cent ans, viendra après plusieurs articles qui évoqueront le village de Castex dans les années de la paix de Saint-Louis.
Ajouter un commentaire
Commentaires